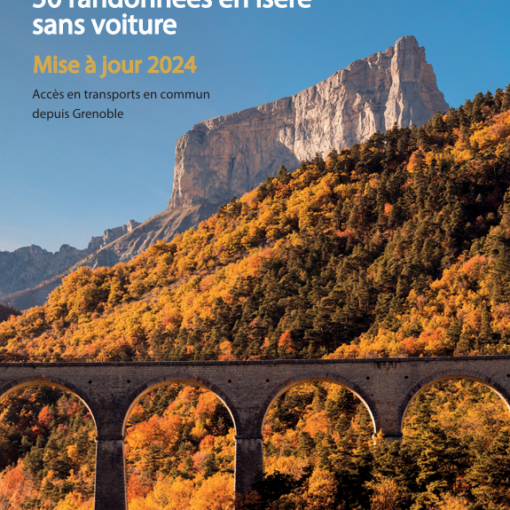Cet été, l’association Alpes Là a pu organiser 2 itinérances Ecotraversées, direction l’Ubaye et les Ecrins. Nouveauté de cette année, un format plus court, sur 3 jours, et sans soutien financier de partenaires, tout en maintenant des tarifs très abordables.
Ecotraversée de l’Ubaye
En Haute-Ubaye, depuis le hameau de Maljasset et son refuge CAF, le séjour était orienté, comme les années passées, sur les glaciers de l’Ubaye. Avant de les rejoindre, nous nous sommes mis en jambe du côté du Plan de Parouart pour une jolie boucle permettant d’atteindre le Plan de Chabrière et ses fameux pillow lava (lave en coussin). En chemin, nous avons justement croisé le géologue de l’étape, Jean-Paul Masse, fin connaisseur de la vallée, qui nous a présenté l’histoire du marbre vert de Morin et les carrières environnantes (plus exploitées de nos jours.
Après une nuit au refuge de Maljasset, et un bon repas, nous avons rejoint les Lacs du Marinet et son refuge-bivouac, en compagnie de Julia Agzou, doctorante qui réalise une partie de ses recherches sur des glaciers rocheux du vallon. A l’entrée du vallon de Mary, nous avons rencontré les médiateurs pastoraux, qui nous ont présenté les bonnes pratiques à adopter à l’approche des troupeaux et des patous et autres chiens de berger.
L’après-midi, après une courte mais raide ascension, nous avons atteint le pied de ce qu’il reste du glacier « blanc » du Marinet. L’occasion de découvrir aussi les glaciers rocheux, beaucoup plus impressionnants. A la redescente, certains ont d’ailleurs voulu prendre un raccourci par un glacier rocheux, ce qui n’était pas le plus rapide !
Le lendemain, nous avons rejoint le Col Marinet puis de Mary, l’occasion de bien voir les différents glaciers rocheux et d’en savoir plus sur le fonctionnement de ces glaciers et leurs évolutions passées et actuelles.
Après une pause pique-nique sur un des nombreux lacs de Roure, nous avons reboucler pour retrouver le village de Maljasset.
Le séjour était déjà fini mais le soir, une conférence sur les glaciers rocheux était donné par Julia Agzou, ainsi qu’une projection du court-métrage « Ecotraversée en Haute-Ubaye » (film réalisé il y a 2 ans par le média Partager c’est sympa).





















Ecotraversée du Vénéon
Fin août, nous avons rejoint la vallée du Vénéon dans les Ecrins, une vallée dont le fond est désormais accessible uniquement avec des navettes. Le RDV était donné la veille sur Bourg d’Oisans, étant donné les horaires de navette :
on a échappé de peu au départ à 6h du mat pour une navette à 7h jusqu’à Venosc puis 15 min plus tard, la seconde navette nous a amené sans encombre jusqu’à Plan du Lac, notre départ rando.
Avec Michel Estève, chercheur en hydrologie (désormais à la retraite), nous avons pu mieux comprendre le fonctionnement du torrent du Vénéon et du bassin versant, en cheminant le long du torrent, pour y découvrir par exemple une petite station de mesure. Après une courte montée, nous avons atteint le village de St Christophe en Oisans pour la pause pique-nique. Avant de repartir, nous avons pu profiter d’un temps de restitution organisé par les doctorants de l’école d’été Mountain Research School, autour de la prise en compte des risques par les acteurs de la vallée, et en particulier lors de la fameuse crue de juin 2024 qui a détruit une bonne partie du hameau de la Bérarde. La randonnée s’est poursuivi pour tenter de rejoindre avant l’orage le refuge de l’Alpe du Pin, situé sur le versant d’en face : la pluie est arrivée dans la montée, donc tout le monde était bien content de trouver ce sympathique refuge. Félix de Montety, historien mais aussi cantonnier de la vallée, nous a rejoint pour nous dévoiler quelques mystères anciens de la vallée et le vécu de la catastrophe de la Bérarde.
Le lendemain, nous avons franchi à nouveau le Vénéon direction le hameau de Champhorent, pour y reprendre la navette… mais la navette n’attendant pas, quelques uns ont dû rejoindre la Bérarde à pied !
A la Bérarde, nous avons retrouvé toute une équipe de chercheurs doctorants qui nous ont présenté plus d’éléments sur le déroulé de la catastrophe et ses origines, en particulier le rôle du glacier de Bonnepierre.
Pour observer ça de plus près, nous avons remonté le vallon des Etançons, avec une nuit au Refuge du Chatelleret, avant de rejoindre le jour suivant la moraine de Bonne pierre et le pied du glacier.
Il ne nous restait plus qu’à redescendre sur la Bérarde pour y prendre la navette… où tout notre groupe a pu rentrer… de justesse.